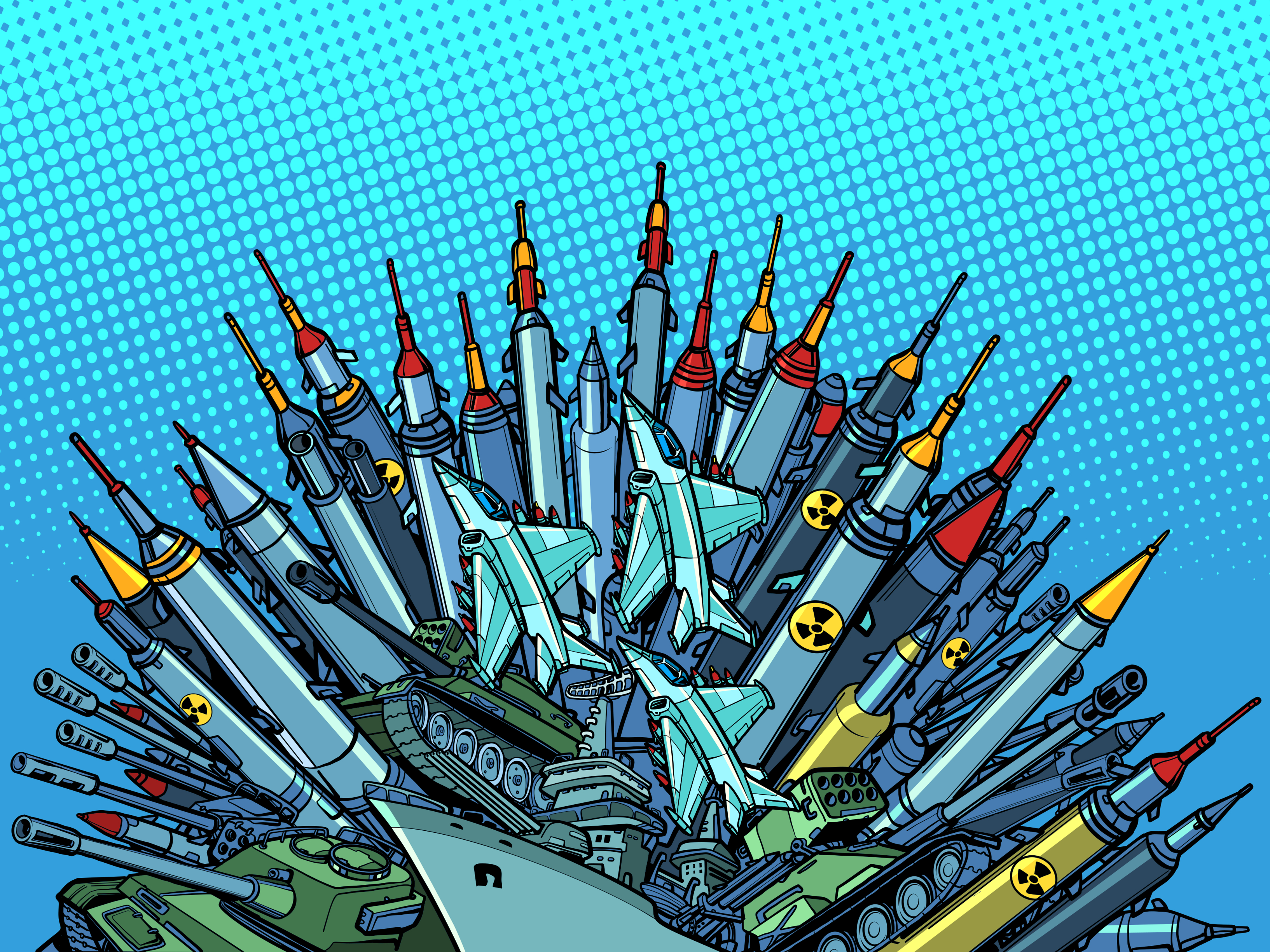Depuis sa fondation, le parti déi Lénk s’est défini par son engagement pacifiste et antimilitariste. Pourtant, à l’occasion de son 22ᵉ congrès, le parti semble amorcer un tournant majeur. Cette évolution soulève des questions essentielles sur l’avenir de la gauche radicale au Luxembourg et au-delà.
Tournant historique : rupture avec les principes fondateurs
Ce dimanche, au congrès de Mertert, déi Lénk devrait acter un changement profond : l’acceptation de la militarisation européenne et l’ouverture aux livraisons d’armes vers des zones de conflit inter-impérialistes. Ce choix marque une rupture notable avec les positions traditionnelles du parti en matière de politique de paix et de solidarité internationaliste.
Déi Lénk, historiquement attaché à l’antimilitarisme, défend désormais la construction d’une défense européenne autonome, une capacité commune de dissuasion et une industrie européenne de l’armement. Là où la priorité était hier au désarmement et au dépassement de la logique militaire, c’est désormais la construction d’un système militaire « progressiste » qui est envisagée.
La deuxième évolution concerne l’adhésion explicite aux livraisons d’armes vers des zones de conflit inter-impérialistes, justifiée par le « droit à la légitime défense ». Ce qui est présenté comme une exception ouvre en réalité la voie à une participation active aux dynamiques dangereuses des conflits entre blocs impérialistes. En mettant le doigt dans l’engrenage, déi Lénk rompt avec sa position historique de refus des exportations d’armes.
Ces deux inflexions – militarisation et soutien aux livraisons d’armes – marquent la fin d’une orientation politique fondée sur la paix, la diplomatie et l’internationalisme. Elles traduisent l’acceptation, par le parti, du nouveau contexte géopolitique européen plutôt que la volonté d’aller à contre-courant.
Une offensive idéologique et culturelle concertée
Ce tournant ne résulte pas d’une évolution interne naturelle. Il s’inscrit dans une dynamique plus large, marquée par une offensive idéologique soutenue. Les grands médias bourgeois et sociaux-démocrates au Luxembourg, comme le Luxemburger Wort et le Tageblatt, jouent un rôle central, avec d’autres médias, dans la diffusion d’un nouveau discours hégémonique qui risque d’emporter de larges secteurs de la gauche luxembourgeoise et européenne.
Ce discours, construit autour de menaces géopolitiques imaginaires, sans base objective réelle, valorise le caractère « responsable » du choix de la course aux armements. Il exerce une pression idéologique et culturelle grandissante. Ceux qui résistent à cette nouvelle orthodoxie sont rapidement marginalisés, accusés d’archaïsme ou de complaisance envers des puissances adverses.
Des pans entiers de la gauche européenne y succombent. Le Luxembourg, à l’avenir, ne fera pas exception. Avec un certain décalage, déi Lénk s’inscrit désormais dans une évolution observée à l’échelle européenne, où les positions antimilitaristes, hier centrales, risquent d’être érodées.
Quelle issue pour une gauche fidèle à ses principes ?
Personne ne peut sérieusement nier que la pression idéologique dans un État de nature bourgeoise – renforcée par un paysage médiatique de plus en plus tourné vers la militarisation et la course aux armements – produit, en temps de tensions géopolitiques, des effets profonds sur la gauche. Ce que nous observons actuellement est un changement de cap progressif : un « Bad Godesberg » pacifiste, qui affecte de larges secteurs de la gauche radicale, non pas par le biais d’un débat ouvert, mais par une pression culturelle et idéologique accrue. Peu à peu, une connivence objective s’est installée entre les appareils idéologiques de l’État bourgeois et une partie des directions politiques des partis de gauche incapables de résister aux multiples pressions qui s’exercent à leur encontre, pour certains par électoralisme, même pas sûr de porter des fruits, pour d’autres par pur opportunisme. Les secteurs de gauche qui résistent sont marginalisés dans le discours officiel et dénoncés comme étant « isolés », « pro-Poutine ».
Devant l’impasse dans laquelle d’importants secteurs du mouvement ouvrier sont en train de se manœuvrer, une question historique ressurgit : « Que faire ? » Il n’existe pas de réponse simple. Mais une chose est certaine : les marxistes, avec d’autres humanistes et pacifistes, qui restent fermes sur leurs positions, portent une grande responsabilité devant l’Histoire. Abandonner le combat pour la paix à l’extrême droite ne leur serait pas pardonné.
Dans la situation actuelle, tant au Luxembourg qu’en Europe, des oppositions internes anticapitalistes et antimilitaristes devront s’articuler autour de positions fermes dans les partis de gauche succombant aux chants de sirènes des élites bourgeoises. Un tel combat devra être mené dans la convergence, en premier lieu, avec des fractions importantes de la société civile, qui ne se laissent pas emporter par les discours officiels et qui, soit dit en passant, ne sont pas si minoritaires qu’on voudrait nous le faire croire. Des sondages d’opinion à travers l’Europe en témoignent régulièrement.
Évidemment, des convergences sont également à rechercher avec des marxistes et humanistes d’autres partis politiques – comme, par exemple, au Luxembourg, le PCL – ou encore avec les collègues dans les syndicats, qui maintiennent une conscience de classe éveillée.
Face au tournant historique qui s’annonce dans une Europe retombant dans les rivalités entre puissances impérialistes, à l’instar de la situation existant avant 1914, il faut s’inspirer de nos aîné·e·s, qui en ces temps si dramatiques ont su résister : Rosa Luxemburg, Karl Liebknecht, Vladimir Ilitch Lénine et beaucoup d’autres. Leur combat est plus actuel que jamais, à condition de ne pas les sacraliser de manière dogmatique !